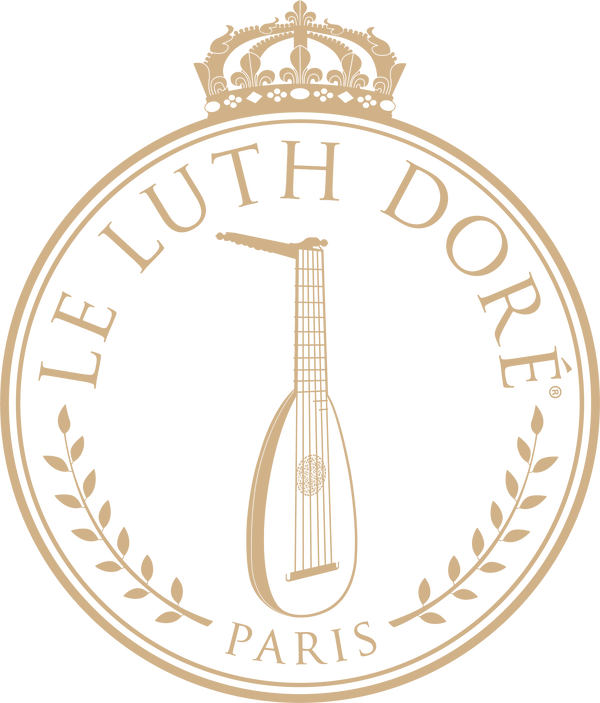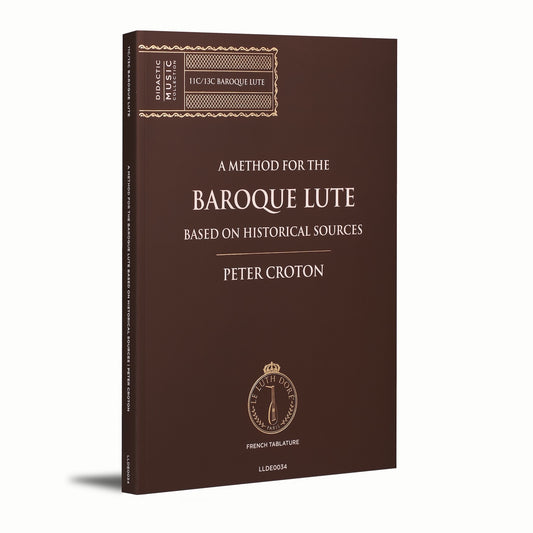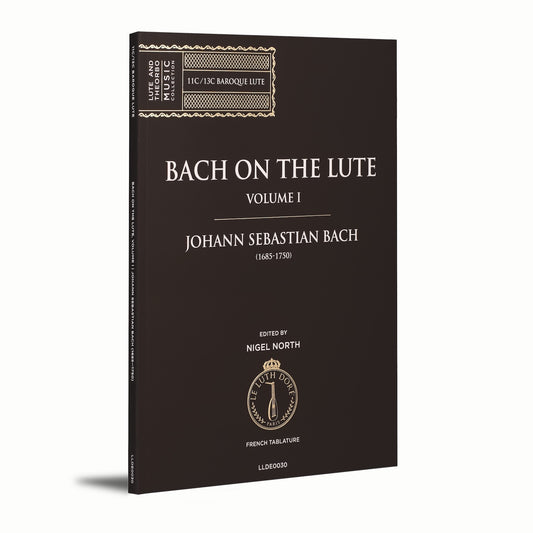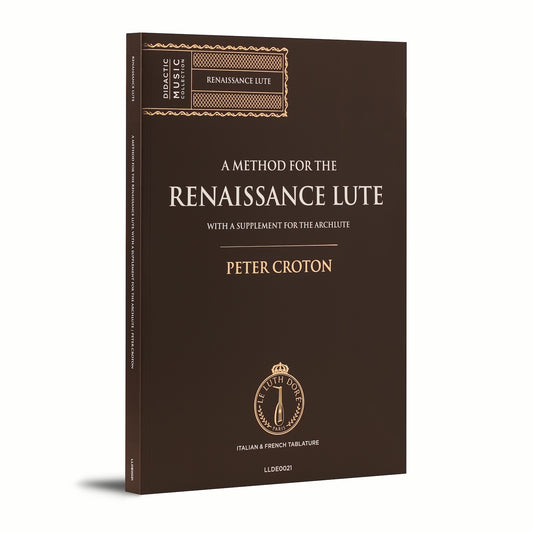Transcrire pour le luth Baroque : la vision historique de Claire Antonini
Partager

Le luth Baroque demeure l’un des instruments les plus fascinants du XVIIᵉ siècle : à la fois miroir de la rhétorique française et témoin d’une pratique musicale fondée sur l’art de la transcription. Dans son travail d’interprète et d’éditrice, Claire Antonini s’inscrit dans cette continuité vivante où la recréation et la fidélité historique s’unissent. Son recueil L’Enchanteresse et autres pièces transposées au luth Baroque, publié par Le Luth Doré® Urtext Editions, illustre avec éclat cette démarche : restituer à l’instrument toute sa profondeur expressive, tout en renouant avec les circulations sonores entre la viole, le clavecin et le luth.
À l’époque Baroque, la transcription n’était pas une adaptation secondaire, mais une pratique essentielle. Les clavecinistes français – Chambonnières, Louis Couperin, Jean-Henri d’Anglebert – ont directement hérité du style brisé des luthistes. Les premières pièces pour clavecin sont d’ailleurs souvent des transpositions d’œuvres pour luth, avant que le clavier ne développe sa propre autonomie. En sens inverse, les luthistes transcrivaient à leur tour des pages du répertoire pour viole ou clavecin, dans un dialogue constant entre instruments.
Il arrive, au fil d’un parcours musical, d’être profondément touché par certaines œuvres écrites pour un autre instrument ; et, à leur écoute, de se dire : “Comme cela sonnerait magnifiquement sur le luth !”

C’est précisément dans cette dynamique que s’inscrit Claire Antonini. En adaptant des œuvres de Marin Marais, Antoine Forqueray, Louis et François Couperin, Chambonnières, Jean-Henri d’Anglebert, Jean-Nicolas Geoffroy et Pierre de La Barre, elle redonne au luth Baroque un rôle de synthèse : celui d’un instrument capable de traduire les nuances, les agréments et la rhétorique du langage français. L’Enchanteresse et autres pièces transposées au luth Baroque n’est donc pas un simple recueil, mais un manifeste artistique où la transcription devient un acte de connaissance et d’interprétation.
Une démarche entre tradition et renouvellement
Claire Antonini ne se contente pas de transcrire : elle réinterprète. Dans sa préface, elle évoque ces instants où, entendant certaines pages pour clavecin ou viole, elle se surprenait à penser : « Ah, cela sonnerait magnifiquement sur le luth Baroque ! » — une intuition qui l’a menée à prolonger le geste des musiciens du Grand Siècle.

La transcription baroque exige un équilibre délicat : respecter la ligne et le contrepoint originaux tout en tenant compte des contraintes de la tessiture, de la résonance et de l’articulation propres au luth. Les transcriptions de Claire Antonini ne sont pas des simplifications, mais des recréations : elles ajustent le texte musical à la respiration, à la polyphonie naturelle et au timbre de l’instrument
Cette démarche réunit deux qualités rarement associées : la rigueur philologique et la liberté poétique. En redonnant vie à ces pages sous ses doigts, Antonini réaffirme la pertinence du luth Baroque dans la pratique moderne — non comme instrument de musée, mais comme médium de sens et d’émotion.
Transcrire, c’est écouter à nouveau ; c’est prolonger l’élan d’une œuvre vers d’autres timbres, d’autres respirations. La musique, lorsqu’elle passe d’un instrument à un autre, se transforme sans se trahir ; elle renaît.

L’Enchanteresse – Transcriptions pour luth baroque


Cette démarche s’inscrit dans une tradition ancienne, comme en témoignent les transcriptions de Robert de Visée ou du manuscrit Milleran. Chaque adaptation cherche à respecter l’esprit de l’original tout en tenant compte des spécificités techniques et expressives du luth. Les œuvres pour clavecin nécessitent souvent des ajustements de tessiture et des simplifications, tandis que les ornements rapides des pièces pour viole doivent être adaptés au jeu du luth.
L’écoute des versions originales est vivement recommandée afin de mieux saisir le caractère et la rhétorique de ces pièces. Ces transcriptions sont une proposition ouverte, invitant chaque interprète à les adapter selon ses moyens techniques et sa sensibilité musicale.
Les compositeurs en filigrane
- Marin Marais (1656-1728) : gambiste virtuose et compositeur du règne de Louis XIV, auteur des Pièces de viole(1686-1725), il incarne la rencontre entre science contrapuntique et éloquence mélodique.
- Antoine Forqueray (1672-1745) : violiste au style fougueux et expressif, dont la virtuosité rivalisait avec celle de Marais.
- Jacques Champion de Chambonnières (v. 1601-1672) : claveciniste et luthiste, fondateur de l’école française de clavecin, maître du style brisé.
- Louis Couperin (1626-1661) : figure charnière entre luth et clavecin, créateur des préludes non mesurés inspirés du jeu des luthistes.
- François Couperin (1668-1733) : « Couperin le Grand », auteur des Pièces de clavecin et du traité L’Art de toucher le clavecin, synthèse des goûts français et italiens.
- Jean-Henri d’Anglebert (1629-1691) : claveciniste du roi et transcripteur de Lully, dont l’écriture élégante prolonge le style du luth.
- Pierre de La Barre (1592-1656) : organiste et luthiste, représentant d’une génération charnière où la polyphonie vocale s’ouvre aux idiomes instrumentaux.
Claire Antonini interprète une chaconne pour luth Baroque
La critique de la Lute Society of Japan
Le recueil L’Enchanteresse et autres pièces transposées au luth Baroque a suscité un écho particulièrement favorable au Japon.
Dans la Newsletter No. 38 (2022) de la Lute Society of Japan, le critique Mitsuru Doyaya a salué : « la sensibilité et la justesse des transcriptions de Claire Antonini », soulignant qu’elles « révèlent la beauté du répertoire français tout en redonnant au luth Baroque la place qu’il mérite ».

« Même dans les passages rapides ou très ornés de la viole, l’écriture pour luth de Claire Antonini reste fluide et naturelle. Elle révèle une compréhension profonde du style français et du phrasé baroque ; chaque ligne de sa transcription respire, comme si elle avait été conçue dès l’origine pour le luth. »
« Les transcriptions de Claire Antonini sont d’une musicalité exemplaire. Ce ne sont pas de simples copies, mais de véritables re-créations qui prolongent l’esprit du Grand Siècle dans notre temps. »
Mitsuru Doyaya, The Lute Society of Japan, 2022
À écouter sur France Musique
Claire Antonini évoque la musique française pour luth du XVIIᵉ siècle dans l’émission « Guitare, guitares » animée par Sébastien Llinarès (France Musique).
"Aujourd'hui, de la musique du XVIIe siècle, et en particulier celle de l'école française de luth, vient de paraître un nouvel enregistrement fabuleux de Claire Antonini. Chacun de ses projets est toujours la promesse d'apprendre beaucoup de choses et de passer un moment musical délicieux et enrichissant." Sébastien Llinarès
Claire Antonini : un parcours d’érudition et de sonorité

Elle a également enregistré les Œuvres pour luth de J. S. Bach, collaboré avec Le Concert d’Astrée, Le Concert Spirituel, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, et travaillé avec des artistes tels que Philippe Jaroussky ou Patricia Petibon. Parallèlement, sa rencontre avec le maître persan Dariush Talaï l’a ouverte aux musiques traditionnelles orientales, dont elle a intégré la sensibilité ornementale et la souplesse rythmique.
Titulaire du Diplôme d’État et du Certificat d’Aptitude, elle enseigne depuis plusieurs années le luth et la musique ancienne dans divers conservatoires. Sa pensée esthétique relie l’exactitude philologique à une intuition sonore profondément poétique : la transcription y devient non seulement un outil d’interprétation, mais un acte de transmission.
Ainsi, Claire Antonini rend au luth Baroque sa dimension intellectuelle, sensible et universelle — celle d’un instrument qui, quatre siècles plus tard, continue de faire résonner la parole du Grand Siècle.